Comment prévenir efficacement les brûlures professionnelles : équipements, formation et organisation au cœur de la sécurité
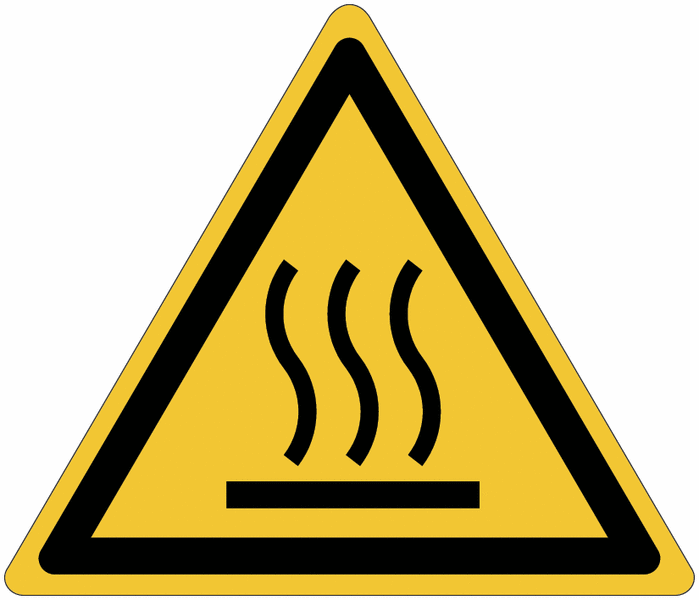
La prévention des risques de brulure ne peut se limiter à des consignes générales. Elle repose sur une approche systémique, intégrant à la fois l’aménagement des postes, le choix des équipements, l’organisation du travail et la formation des équipes. Prévenir, c’est anticiper chaque facteur de risque de brulure en tenant compte des spécificités du terrain pour réduire les accidents et garantir une véritable culture de sécurité.
Équipements de Protection Individuelle (EPI)
L’efficacité des EPI dépend de leur adaptation au type de risque, de leur qualité, mais aussi de leur bon usage quotidien. L’INRS rappelle que les brûlures représentent l’un des risques pour lesquels le choix des EPI doit être le plus ciblé. Les équipements doivent être conformes aux normes européennes (EN ISO, EN 407, EN 388, EN 511, etc.), testés, et compatibles avec l’activité réelle sur le terrain.
Pour les brûlures thermiques
Les travailleurs exposés à des sources de chaleur ou de flamme doivent porter des protections contre la conduction et la convection de chaleur, parmi lesquels :
- Gants résistants à la chaleur (norme EN 407), souvent en croûte de cuir ou textile technique,
- Vêtements ignifuges (norme ISO 11612) : pantalons, blousons, tabliers pour soudeur, cagoules anti-flamme,
- Chaussures de sécurité pour milieux chauds : semelle antichaleur, coque renforcée, tige résistante aux projections de métal fondu,
- Pare-visages, lunettes ou écrans faciaux : indispensables en cas de projection (soudure, fonderie).
Par exemple, un soudeur qui travaille sur pièce inclinée doit impérativement porter une cagoule, un tablier cuir et des manchettes pour éviter les projections sur le buste et les bras.
Pour les brûlures chimiques
L’EPI chimique doit résister aux produits manipulés (acide, base, solvant) et protéger toutes les zones d’exposition possible : peau, yeux, voies respiratoires.
- Gants anti-acides ou polyvalents (norme EN 374) selon les fiches de données de sécurité (FDS),
- Combinaisons ou tabliers en PVC, nitrile ou Tychem selon les produits,
- Lunettes étanches et visière si risque de projection au visage,
- Douche de sécurité et station de rinçage oculaire à moins de 10 secondes du poste à risque (norme EN 15154).
Par exemple, dans un laboratoire, un opérateur doit systématiquement porter des gants, lunettes et blouse imperméable pour manipuler une base forte.
Pour les brûlures électriques
Les EPI électriques doivent isoler, résister aux arcs et éviter tout contact accidentel avec des parties actives sous tension.
- Gants isolants en latex naturel ou composite (norme EN 60903),
- Vêtements de protection contre les arcs électriques (norme EN 61482-2) : combinaison, blouson, sous-vêtements techniques,
- Chaussures isolantes,
- Tapis ou escabeaux diélectriques,
- Outils isolés (tournevis, pinces, testeurs).
Par exemple, lors d’une intervention sous tension en basse tension, l’électricien doit porter une visière anti-arc, des gants classe 0 ou 1 et une veste normée.
Pour les brûlures par rayonnement (UV ou chaleur)
Les protections concernent surtout les travailleurs en extérieur ou les opérateurs exposés à des sources de chaleur rayonnante.
- Vêtements longs et légers anti-UV (norme UPF 50+),
- Casquettes avec protection nuque,
- Lunettes de soleil normées (EN 172 ou EN 166),
- Crème solaire indice 50, réappliquée régulièrement,
- Accessoires rafraîchissants : gilets, serviettes humides, bandanas.
Par exemple, un agent de voirie effectuant de la peinture au sol en plein été doit combiner vêtements couvrants respirants et casquette avec pare-nuque.
Pour les brûlures par frottement
Souvent négligées, ces blessures peuvent être évitées grâce à desvêtements et des EPI ergonomiques.
- Tenues ajustées, sans couture saillante ni friction avec les articulations,
- Genouillères, coudières, gants antidérapants pour les postes sollicitant des appuis prolongés,
- Sous-vêtements techniques pour éviter les échauffements par transpiration.
Par exemple, un cariste en entrepôt frigorifique doit porter des manches longues bien fixées pour éviter les frottements répétés contre le chariot.
Pour les brûlures par le froid
Les protections thermiques doivent préserver la chaleur corporelle tout en permettant une bonne mobilité.
- Vêtements multicouches et respirants, avec doublure thermique,
- Gants doublés en cuir ou textile isolant, imperméables si exposition à la neige ou l’humidité,
- Chaussures fourrées avec semelles antidérapantes,
- Crèmes protectrices contre le froid, à appliquer sur les zones non couvertes.
Par exemple, en chambre froide à -25 °C, un manutentionnaire doit porter une combinaison normée EN 342 et des gants EN 511 pour éviter les engelures aux mains.
Récapitulatif
| Type de brûlure | Équipements de protection recommandés |
| Brûlure thermique | Gants résistants à la chaleur (EN 407), vêtements ignifuges (ISO 11612), chaussures antichaleur, pare-visages, lunettes |
| Brûlure chimique | Gants anti-acides ou polyvalents (EN 374), combinaison ou tablier PVC/Nitrile/Tychem, lunettes étanches, douche oculaire (EN 15154) |
| Brûlure électrique | Gants isolants (EN 60903), vêtements anti-arc (EN 61482-2), chaussures isolantes, outils isolés, tapis/escabeaux diélectriques |
| Brûlure par rayonnement | Vêtements anti-UV (UPF 50+), lunettes solaires (EN 172/166), casquette pare-nuque, crème solaire SPF 50, accessoires rafraîchissants |
| Brûlure par frottement | Tenues ajustées sans couture saillante, genouillères, coudières, gants antidérapants, sous-vêtements techniques |
| Brûlure par froid | Vêtements multicouches (EN 342), gants isolants et imperméables (EN 511), chaussures fourrées, crème protectrice contre le froid |
Formation et sensibilisation des travailleurs
Même les meilleurs équipements de protection perdent toute efficacité s’ils sont mal compris, mal portés ou tout simplement ignorés. C’est pourquoi la formation constitue un pilier fondamental de la prévention des brûlures en milieu professionnel. Il ne s’agit pas simplement de répondre à une obligation réglementaire, mais de favoriser une vraie appropriation des risques et des bons réflexes par tous les travailleurs concernés.
Selon l’INRS, les entreprises qui intègrent des actions de formation régulières sur les risques spécifiques à leurs métiers constatent une réduction notable des accidents liés aux brûlures. Cet engagement passe par une sensibilisation ciblée, concrète et adaptée aux conditions réelles de travail.
Une formation efficace permet d’abord à chaque salarié de connaître les dangers spécifiques à son poste : exposition à la chaleur, manipulation de produits corrosifs, travail sous tension, interventions en environnements froids…
Elle aide également à reconnaître les signes avant-coureurs d’un incident, comme une fuite, une surchauffe anormale ou les premiers symptômes d’une brûlure. En parallèle, elle développe une vraie maîtrise de l’usage des EPI : comment les choisir, les ajuster, les entretenir, et surtout les porter systématiquement dans les bons contextes. Enfin, elle permet de savoir réagir en cas d’accident en intégrant les gestes de premiers secours adaptés au type de brûlure.
Certaines méthodes de formation se révèlent particulièrement efficaces : les « quarts d’heure sécurité » hebdomadaires permettent de maintenir l’attention sur les bonnes pratiques, même entre deux sessions formelles. Les mises en situation réelles, encadrées, ou l’usage de la réalité virtuelle favorisent l’apprentissage des gestes en conditions proches du terrain.
Enfin, les retours d’expérience à la suite d’un « presque accident » renforcent l’ancrage des connaissances et nourrissent une dynamique collective d’amélioration continue.
Prenons l’exemple d’un technicien chimiste qui, chaque trimestre, participe à une simulation impliquant une projection de produit acide. En répétant ces gestes dans un cadre sécurisé, il renforce ses réflexes et sera bien plus réactif en situation réelle.
C’est ce type de préparation qui fait la différence entre un incident maîtrisé… et un accident grave.
Maintenance et contrôle des équipements
Les brûlures d’origine technique, souvent spectaculaires, peuvent aussi être évitées… à condition que les équipements soient entretenus de manière rigoureuse. Dans de nombreux cas, les incidents graves trouvent leur origine dans une maintenance insuffisante, un usage inadapté du matériel ou une absence de procédure claire lors de son utilisation.
Les données disponibles rappellent combien l’entretien est un levier de prévention à ne pas négliger. Une machine mal réglée, un détendeur usé, une pièce thermique déréglée : ces défaillances, souvent silencieuses, peuvent à tout moment devenir critiques. Il ne suffit pas d’avoir le bon équipement : encore faut-il qu’il fonctionne correctement, en toute sécurité, et dans les conditions prévues.
Instaurer une politique de maintenance efficace implique différents volets : d’abord, planifier des contrôles réguliers, avec une fréquence adaptée au niveau de sollicitation de chaque équipement, certaines machines critiques peuvent exiger un contrôle hebdomadaire, d’autres mensuel ou trimestriel. Il est tout aussi essentiel de tenir une traçabilité rigoureuse des interventions effectuées, via un carnet de maintenance physique ou un registre numérique, accessible et mis à jour.
Avant toute intervention sur un dispositif potentiellement dangereux, un protocole strict de consignation doit être appliqué : verrouillage, étiquetage clair, mise hors tension effective. Et lorsqu’un outil est endommagé, usé ou non conforme, son remplacement ne doit jamais être différé sous prétexte de délai ou de rendement.
Dans un atelier de soudure, par exemple, les chalumeaux et les détendeurs sont contrôlés toutes les trois semaines. Grâce à cette régularité, trois incidents liés à des fuites de gaz ont pu être évités en moins d’un an. Ce type de démarche illustre à quel point la prévention technique est un investissement rentable pour la sécurité des opérateurs comme pour la continuité de l’activité.
La maintenance n’est donc pas une opération ponctuelle, mais une stratégie de maîtrise du risque, inscrite dans le quotidien de l’entreprise. Elle engage autant les techniciens que les responsables de production dans une logique de vigilance partagée.
Conditions de travail et organisation
Les conditions de travail, entendues au sens large, agencement des postes, circulation des personnes, entreposage des substances dangereuses, ventilation des locaux, jouent un rôle déterminant dans la survenue ou la prévention des brûlures professionnelles. Ce sont souvent des éléments discrets de l’environnement de travail qui, mal pensés ou négligés, deviennent les déclencheurs silencieux d’accidents parfois graves.
L’organisation des flux de circulation, par exemple, doit anticiper les situations de croisement entre opérateurs et zones à risque thermique ou chimique. Dans un atelier, une cuisine collective ou un laboratoire, le simple fait de traverser un espace où circulent des liquides chauds ou des gaz sous pression peut suffire à générer une situation critique. Un plan de circulation bien conçu limite ces points de contact, fluidifie les déplacements et réduit considérablement le risque d’accident.
La ventilation constitue un autre levier essentiel. Dans les zones à émissions thermiques ou chimiques, soudures, bains acides, opérations de nettoyage intensif, l’air doit être renouvelé en continu par des dispositifs adaptés. L’INRS rappelle que des locaux correctement ventilés permettent de réduire de façon significative l’incidence des brûlures par inhalation de produits chimiques, en abaissant la concentration des vapeurs irritantes dans l’air ambiant.
L’organisation passe aussi par une gestion rigoureuse des matières dangereuses : les produits inflammables ou corrosifs doivent être stockés dans des armoires spécifiques, ventilées, clairement identifiées et sécurisées avec un accès limité au personnel formé.
Enfin, des dispositifs de protection collective doivent être intégrés à l’environnement de travail :
- Ecrans thermiques,
- Barrières anti-projection,
- Alarmes de surchauffe,
- Extincteurs automatiques,
- Rideaux de séparation pour isoler physiquement les zones sensibles.
L’exemple d’une cuisine centrale est parlant : après avoir revu son plan de circulation et installé des séparateurs physiques entre les zones de cuisson et de préparation, l’établissement a réduit de moitié les incidents liés à l’ébullition de liquides brûlants. Ce type de réaménagement montre qu’une organisation réfléchie et adaptée aux risques spécifiques du terrain peut transformer profondément les conditions de sécurité.
En somme, maîtriser l’environnement de travail ne consiste pas seulement à protéger, mais aussi à prévoir, organiser, structurer les espaces de manière intelligente, afin de neutraliser les dangers à la racine.
Traçabilité des incidents : une mémoire pour mieux prévenir
Lorsqu’un accident survient, la réaction immédiate est essentielle, mais elle ne suffit pas. Ce qui fait la différence à long terme c’est la capacité d’une organisation à enregistrer, analyser et tirer des enseignements concrets de chaque incident ou “presque accident”. La traçabilité devient alors un outil clé, non seulement pour respecter les obligations réglementaires, mais surtout pour construire une politique de prévention fondée sur des faits observés.
Tenir un registre des brûlures, même mineures, permet de repérer des motifs récurrents : un outil défectueux utilisé trop longtemps, une zone de travail mal ventilée, un EPI mal adapté à un poste spécifique. Ces éléments, consignés systématiquement, alimentent une veille interne qui aide à ajuster les formations, à adapter les équipements, à réaménager les espaces ou à mettre à jour les procédures.
Mais pour que cette traçabilité soit utile, elle doit être simple, rapide à renseigner et intégrée quotidiennement. Cela passe souvent par des supports numériques ou des formulaires courts, accessibles à tout moment, couplés à une sensibilisation claire : signaler un incident n’est pas dénoncer, mais protéger ses collègues et soi-même à l’avenir.
L’analyse des incidents doit ensuite donner lieu à un retour collectif, sous forme de compte-rendu, de réunion sécurité ou d’affichage synthétique. Trop souvent, les constats restent confidentiels, voire sans suite. Or, lorsqu’ils sont partagés, discutés, intégrés dans une démarche d’amélioration continue, les retours d’expérience deviennent des leviers puissants de changement.
Cette approche vaut également pour les “presque accidents” : ces situations où l’incident a été évité de justesse. Elles sont précieuses car elles révèlent les failles avant qu’elles ne causent des blessures. Documenter ces signaux faibles, c’est anticiper plutôt que réparer.
En somme, la traçabilité ne doit pas être perçue comme une contrainte administrative, mais comme la mémoire active de l’entreprise face au risque. Elle transforme les incidents passés en solutions futures et participe pleinement à la création d’une culture sécurité solide et partagée.
Les mesures d’urgence en cas d’accident
En cas de brûlure sur le lieu de travail, la rapidité et l’adéquation des gestes de premiers secours sont cruciales. Ils permettent de limiter l’extension des lésions, d’éviter les complications et, dans certains cas, de sauver la vie ou les membres du salarié. Selon l’INRS, une prise en charge dans les 10 premières minutes réduit significativement la gravité de la brûlure et améliore le pronostic de récupération.
Chaque type de brûlure exige une réponse spécifique. Voici les protocoles essentiels à connaître.
Brûlures thermiques
En cas de brûlure thermique, il est crucial de refroidir immédiatement la zone touchée avec de l’eau tiède, idéalement entre 15 et 25 °C pendant 10 à 15 minutes. L’usage de glace ou d’eau très froide est déconseillé, car cela peut aggraver la lésion en provoquant une hypothermie locale. Si aucun point d’eau n’est disponible, on peut recourir à une solution de secours : envelopper la zone avec une couverture isotherme, appliquer un gel hydratant adapté ou utiliser un tissu propre humidifié.
Il ne faut jamais percer les cloques ni appliquer de corps gras qui risqueraient d’infecter la plaie ou de gêner son évaluation médicale. Il est également recommandé de retirer les vêtements et bijoux autour de la zone brûlée, à condition qu’ils ne soient pas collés à la peau.
La gravité de la brûlure détermine la suite à donner : si la surface touchée dépasse celle de la paume de la main ou si la brûlure est localisée sur le visage, les mains, les pieds, les articulations ou les voies respiratoires, il faut consulter sans délai ou contacter les secours. Dans les environnements professionnels à risque, une douche d’urgence doit être installée à proximité immédiate, à moins de dix secondes d’accès, afin de garantir une intervention rapide dès les premières secondes critiques.
Brûlures chimiques
Face à une brûlure chimique, la priorité est de retirer rapidement les vêtements souillés tout en évitant d’étaler la substance sur une zone plus large. Le rinçage doit ensuite être immédiat, abondant et prolongé : il est recommandé de laisser couler de l’eau claire sur la zone touchée pendant au moins 15 minutes sans interruption, même si la douleur semble modérée ou s’atténue rapidement. L’objectif est d’éliminer totalement l’agent chimique dont les effets peuvent se poursuivre en profondeur bien après le contact initial.
Il ne faut surtout pas chercher à neutraliser soi-même le produit sauf si le protocole de l’entreprise prévoit l’usage d’une solution spécifique comme la diphotérine®. Cette intervention doit rester encadrée par une consigne claire, car une mauvaise neutralisation peut empirer les lésions.
En cas de projection dans l’œil, le rinçage doit s’effectuer à l’aide d’une solution oculaire stérile ou, à défaut, d’eau propre, en gardant la tête penchée vers le bas afin d’éviter toute contamination croisée. Quelle que soit l’apparence de la blessure, une consultation médicale immédiate est indispensable : certaines brûlures chimiques sont trompeusement indolores au début, mais évoluent de façon insidieuse et peuvent causer des dégâts profonds et irréversibles.
Enfin, pour permettre une prise en charge adaptée, la fiche de données de sécurité (FDS) du produit concerné doit impérativement être transmise aux secours ou au personnel médical. Elle contient des informations précieuses sur les substances en cause, leur niveau de danger et les traitements d’urgence recommandés.
Brûlures électriques
En cas de brûlure électrique, la toute première action consiste à couper l’alimentation électrique sans jamais toucher la victime tant que le courant n’est pas neutralisé. Le danger n’est pas uniquement thermique : le passage du courant à travers le corps peut entraîner un arrêt cardiaque, une paralysie temporaire, ou des lésions profondes invisibles en surface.
Une fois la personne mise hors de danger immédiat, il faut vérifier sa respiration et son rythme cardiaque. Ces signes vitaux peuvent être perturbés même si la victime est consciente, car l’atteinte des muscles ou du cœur ne se manifeste pas toujours immédiatement.
L’appel aux secours doit être immédiat (SAMU 15, pompiers 18 ou 112) sans attendre l’apparition de symptômes visibles. Contrairement aux brûlures classiques, il ne faut ni appliquer d’eau ni poser de pommade sur la peau. La priorité est de surveiller attentivement l’état général de la victime en attendant les professionnels, notamment en cas de perte de connaissance, de difficultés respiratoires ou de douleurs thoraciques.
Les brûlures électriques sont particulièrement trompeuses : un point d’entrée discret sur la main ou le pied peut masquer une atteinte grave des tissus internes, muscles, nerfs, organes. Seule une évaluation médicale complète permet de mesurer l’étendue réelle des lésions.
Brûlures par rayonnement
Les brûlures causées par le rayonnement, notamment solaire ou infrarouge, doivent être prises en charge dès les premiers signes, même si elles paraissent superficielles. Il est recommandé de refroidir doucement la zone touchée à l’aide d’eau fraîche ou d’un linge humide pendant quelques minutes, afin de soulager la sensation de chaleur et limiter la progression de l’inflammation cutanée.
Une fois la peau apaisée, on peut appliquer une crème hydratante ou apaisante, sans parfum, de préférence enrichie en ingrédients naturels comme l’aloé vera. Ces soins favorisent la récupération cutanée tout en réduisant l’inconfort.
Il est essentiel d’éviter toute nouvelle exposition à la source de chaleur ou au soleil dans les heures qui suivent, même si la brûlure semble bénigne. La peau fragilisée devient plus sensible aux agressions extérieures et peut aggraver la lésion si elle n’est pas protégée.
Il faut aussi surveiller l’évolution de la zone concernée, en particulier l’apparition de cloques, de rougeurs persistantes, ou de signes d’infection. Ces indicateurs doivent alerter et motiver une consultation.
Lorsque la brûlure par rayonnement s’accompagne de symptômes généraux tels que maux de tête, nausées ou étourdissements, cela peut signaler un coup de chaleur associé. Dans ce cas, il est recommandé d’installer la personne à l’ombre, de la faire s’allonger et de l’aider à se réhydrater. Si les symptômes persistent ou s’aggravent, un avis médical s’impose rapidement.
Brûlures par frottement
Les brûlures par frottement, souvent considérées comme superficielles, peuvent néanmoins devenir gênantes, douloureuses ou sources d’infection si elles ne sont pas correctement traitées. Dès que la lésion est identifiée, il convient de nettoyer la zone à l’eau claire avec un savon doux afin d’éliminer les impuretés et limiter le risque microbien.
Une fois la peau propre, l’application d’un antiseptique non alcoolisé permet de désinfecter en douceur sans irriter davantage la surface lésée. Il est ensuite recommandé de protéger la brûlure avec une crème cicatrisante ou un pansement non adhérent qui favorisera la régénération cutanée tout en évitant les frottements supplémentaires.
Si la plaie est ouverte, suinte, reste douloureuse au-delà de quelques heures ou montre des signes d’aggravation, une consultation médicale est préférable. De même, si la brûlure ne montre aucune amélioration après 48 heures ou commence à s’infecter, un suivi par un professionnel de santé permettra d’éviter des complications plus lourdes.
Même mineures, ces brûlures nécessitent une attention adaptée, en particulier lorsqu’elles se situent à des endroits sensibles ou soumis à des frottements répétés, comme les poignets, les genoux, les chevilles ou le bas du dos.
Brûlures par froid (gelures)
Les brûlures par froid, aussi appelées gelures, nécessitent une prise en charge précise et délicate. Le premier réflexe à adopter est de ne jamais frotter ni masser la zone atteinte, même si elle est engourdie. Ces gestes peuvent aggraver les lésions en endommageant davantage les tissus déjà fragilisés par le gel.
Il faut retirer immédiatement les vêtements humides ou gelés, puis procéder à un réchauffement progressif. Celui-ci peut être effectué à l’aide de compresses tièdes, d’une couverture thermique ou simplement en plaçant la zone au contact de la chaleur corporelle, mais sans jamais recourir à l’eau chaude qui risquerait de provoquer une brûlure secondaire sur une peau insensible.
Lorsque la peau devient noire, cartonnée, cloquée ou totalement insensible, il s’agit d’une urgence médicale. Ces signes traduisent une atteinte profonde, parfois irréversible, des tissus. La personne doit être prise en charge sans délai par un service hospitalier.
Dans tous les cas, la phase de réchauffement doit être lente et contrôlée, sans exposition brutale à une source de chaleur intense. Une surveillance continue est également indispensable pour détecter d’éventuelles complications : douleur persistante, fièvre, œdème, ou apparition de cloques retardées.
Récapitulatif
| Type de brûlure | Origine | Secteurs concernés | Gravité potentielle | Premiers secours clés |
| Brûlure thermique | Contact direct avec une flamme, un métal ou liquide chaud (bitume, huile, vapeur). | BTP, métallurgie, chaudronnerie, restauration, cuisine collective. | Peut aller d’une simple rougeur (1er degré) à une nécrose complète nécessitant une greffe (3e degré). | Refroidir la zone à l’eau tiède pendant 15 min, ne pas percer les cloques, consulter si étendue. |
| Brûlure chimique | Contact avec acide fort, base concentrée, solvant, produit corrosif. | Industrie chimique, nettoyage industriel, agroalimentaire, hôpitaux, agriculture. | Lésions parfois invisibles au début, très profondes selon la substance (ex. acide fluorhydrique). | Rincer abondamment pendant 15 min, retirer les vêtements contaminés, consulter rapidement. |
| Brûlure électrique | Contact avec une source électrique sous tension, arc électrique. | Maintenance électrique, BTP, industrie, installations techniques. | Dommages internes graves, invisibles à l’œil nu (atteinte cardiaque, nerfs, muscles). | Couper l’alimentation, ne pas toucher la victime sans protection, surveiller, appeler les secours. |
| Brûlure par rayonnement | Exposition prolongée à une source de chaleur rayonnante ou aux UV (soleil, four, flamme nue). | BTP, travaux extérieurs, fonderie, jardinage, maintenance en extérieur. | Brûlures superficielles à modérées, avec risques de déshydratation ou de coup de chaleur. | Refroidir la peau, appliquer une crème apaisante, éviter toute nouvelle exposition solaire. |
| Brûlure par frottement | Friction de la peau contre une surface dure ou un textile abrasif (cordes, sols, outils). | Manutention, logistique, BTP, métiers manuels ou en contact prolongé avec des surfaces. | Irritations, abrasions, voire infection si non soignée ; parfois négligée car peu douloureuse au début. | Nettoyer, désinfecter, appliquer une crème cicatrisante ou un pansement adapté. |
| Brûlure par froid | Exposition prolongée au froid extrême ou contact avec des surfaces gelées (surgelés, extérieurs). | Agroalimentaire (chambres froides), plein air, logistique frigorifique. | Engelures modérées à graves, nécrose possible, insensibilité locale trompeuse (urgence si peau noircie). | Ne pas frotter, réchauffer doucement avec des vêtements secs, consulter en cas de douleurs ou lésions. |
Les brulures au travail
Sources

Commentaires
Laisser un commentaire